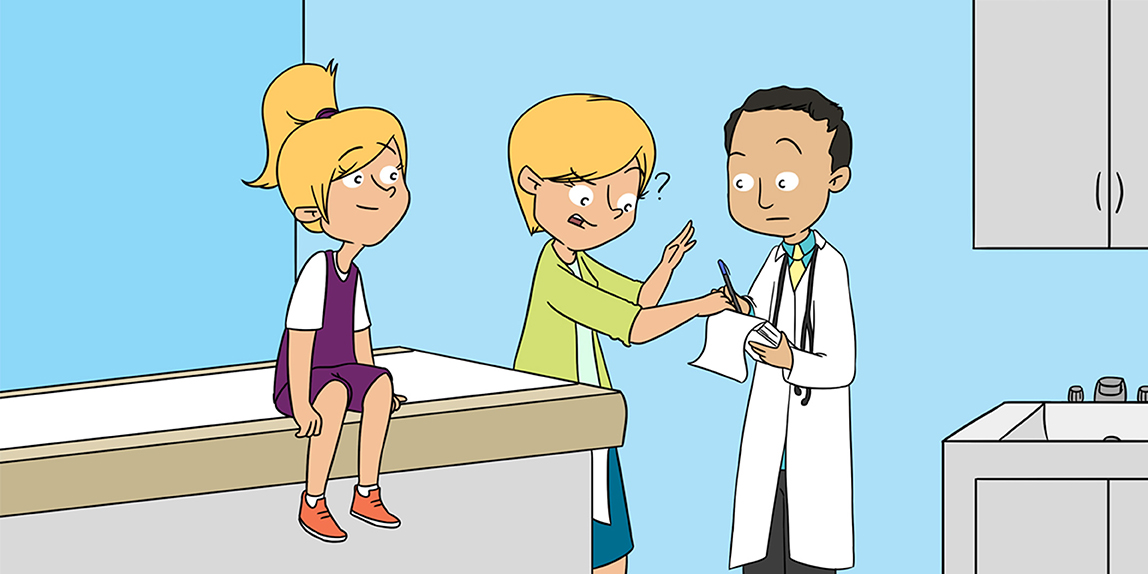Résumé
Les vaccins protègent contre les maladies en préparant notre système immunitaire à combattre les microbes qui les causent. C’est grâce aux vaccins que les enfants échappent à de nombreuses maladies graves comme la poliomyélite, les méningites ou la coqueluche. Pourtant, certaines personnes refusent l’utilisation des vaccins car elles se méfient de leurs fabricants et des autorités qui organisent leur administration. Cette attitude négative expose toute la population à des risques importants. La méfiance vis-à-vis des vaccins remonte à leur origine. Cet article fait appel à trois exemples historiques avant de discuter la situation actuelle dans nos pays, à l’heure de la COVID-19.
La grippe espagnole (1918)
Il y a 100 ans, le monde a connu la pire pandémie de grippe de son histoire. Il s’agissait de la grippe dite espagnole bien qu’elle n’ait pas plus touché l’Espagne que d’autres pays. Une pandémie est une épidémie qui touche le monde entier, et cette grippe a été bien plus dangereuse que celle qui sévit chaque hiver. En trois ans, on estime que la pandémie a tué entre 50 et 100 millions de personnes. C’est plus que la Première Guerre mondiale, probablement plus que la Seconde Guerre mondiale, et peut-être même plus que les deux guerres réunies.
Aujourd’hui, nous savons que la grippe est causée par un virus, tout comme la COVID-19. A l’époque, les médecins pensaient qu’elle était causée par des bactéries et ils ont tenté de maîtriser la pandémie par des vaccins anti-bactérie. Bien entendu, ce fut un échec. L’attitude des populations vis-à-vis de ces vaccins a été très différente selon les pays. Dans les pays riches comme les États-Unis et la France, où les gens faisaient globalement confiance à leurs gouvernements, de nombreuses personnes ont accepté de se faire vacciner. Dans les pays pauvres, le ressentiment à l’égard des gouvernants s’est traduit par un large refus des vaccins. Ainsi, l’Inde, sous protectorat britannique, gardait la mémoire de la souffrance imposée par les Anglais aux populations indiennes lors d’une récente épidémie de peste. Les familles avaient été séparées et leurs maisons parfois brûlées. On comprend dès lors que les populations refusaient d’obéir aux injonctions de ceux qui les avaient fait souffrir sous prétexte de les protéger [1].
La rumeur du vaccin polio contaminé au nigéria (2003)
En 2003, une rumeur se répand au Nigéria selon laquelle le vaccin contre la poliomyélite serait contaminé par le virus du SIDA ou des toxines pouvant causer des cancers ou rendre stérile. Les chefs religieux et politiques du nord du pays craignaient une conspiration américaine visant à propager le VIH et à provoquer l’infertilité. La distribution des vaccins a dès lors été arrêtée dans cinq états du pays. Les conséquences ne se sont pas fait attendre : le nombre de nouveaux cas de cette maladie effrayante (elle cause des paralysies multiples) a été multiplié par cinq et la maladie s’est propagée au-delà des frontières du pays, mettant en péril le programme mondial d’éradication de la poliomyélite [2].
Grâce à une campagne d’information bien conduite et un dialogue constructif avec les dirigeants des états concernés, la vaccination reprendra dans tout le pays. Cet exemple démontre qu’il est possible de venir à bout des rumeurs et informations mensongères [3].
L’épidemie ebola au congo (2018)
En août 2018, une maladie dangereuse appelée Ebola s’est déclarée en République démocratique du Congo. Des équipes de médecins et d’experts de différents pays se sont mobilisées pour aider à lutter contre l’épidémie grâce à des vaccins dont l’efficacité et la sûreté étaient formellement démontrées. Pourtant, la maladie a continué à se propager et à faire de nombreuses victimes. Pourquoi le vaccin n’a-t-il pas arrêté la maladie ?
Il s’est avéré qu’une grande partie de la population refusait de se faire vacciner. Pour le comprendre, il faut savoir que la République du Congo a été l’objet de plusieurs guerres et changements de gouvernement. Les gouvernants du pays ont ainsi perdu la confiance de la population. C’est ainsi que des rumeurs niant l’existence même de la maladie se sont répandues. Quant aux vaccins, une partie de la population considère que ce sont des poisons introduits par des puissances étrangères. Toutes ces fausses informations ont beaucoup compliqué la lutte contre cette maladie très grave [4].
L’hésitation à l’égard des vaccins dans les pays riches
De fausses informations sur de prétendus effets néfastes des vaccins ont alimenté les doutes et les mouvements anti-vaccins dans nos pays au cours de trente dernières années. C’est l’affirmation par le médecin Wakefield de la responsabilité du vaccin contre la rougeole dans le déclenchement de l’autisme chez l’enfant qui aura les plus graves conséquences. Soutenue par une publication dans une revue scientifique réputée (The Lancet) qui finira par reconnaître que l’étude rapportée était complètement fausse, la théorie du docteur Wakefield conduira de nombreux parents à renoncer à vacciner leurs enfants. Alors que la rougeole avait pratiquement disparu dans nos régions, les enfants non-vaccinés allaient être à l’origine de nouveaux foyers de cette maladie qui peut être très grave jusqu’à entraîner la mort. Cette situation a conduit certains pays dont la France à rendre obligatoire ce vaccin ainsi que d’autres de manière à protéger les enfants contre les maladies infectieuses qui les menacent.
La campagne de vaccination contre l’hépatite B en France dans les années 90 a également fait l’objet d’une controverse importante sur l’implication de ce vaccin dans le déclenchement de cas de sclérose en plaques, une maladie grave du système nerveux. Elle a même conduit à suspendre la vaccination des écoliers en 1998, avant que plusieurs études permettent d’écarter définitivement un lien entre le vaccin et la maladie. Cet épisode s’est inscrit dans le contexte d’une méfiance générale vis-à-vis des autorités de santé, causée par l’affaire du sang contaminé qui a causé de nombreux cas de SIDA.
L’hésitation vaccinale est ainsi entretenue par une remise en cause générale des autorités, qu’il s’agisse d’experts scientifiques ou de responsables politiques en charge de la santé. S’y ajoute les opinions négatives très répandues sur l’industrie pharmaceutique, accusée de privilégier le profit financier au détriment des intérêts de santé publique.
La vaccination contre la COVID-19 a remis la question de l’hésitation vaccinale à l’avant-plan de l’actualité. Alors que l’efficacité de ces vaccins pour prévenir les formes graves de l’infection par le coronavirus est démontrée de façon incontestable et que toutes les données disponibles sur leur sécurité sont rassurantes, certains contestent leur utilité et mettent à mal la lutte contre la pandémie par leur refus de se faire vacciner. Il s’est avéré que les fausses informations circulant sur les réseaux sociaux ont souvent plus d’influence sur la population que les campagnes d’information objective lancées par les autorités. Pour accroître la couverture vaccinale, plusieurs pays ont mis en place des systèmes de ≪ pass sanitaire ≫ qui impose la vaccination à toutes celles et tous ceux qui souhaitent retrouver une vie sociale normale.
Devant le risque important de nouvelles pandémies dans les années à venir, il est essentiel de préparer les nouvelles générations à les affronter en leur expliquant l’importance de la vaccination. Cet effort éducatif doit porter dès le plus jeune âge et être centré sur la prévention des maladies tout au long de la vie.
Déclaration d’utilisation des outils d’ia
Tout texte alternatif fourni avec les figures de cet article a été généré par Frontiers grâce à l’intelligence artificielle. Des efforts raisonnables ont été déployés pour garantir son exactitude, notamment par une relecture par les auteurs lorsque cela était possible. Si vous constatez des problèmes, veuillez nous contacter.
Contributions à la version française
TRADUCTEUR: Caroline Van Swieten et Michel Goldman
Conflit d’intérêts
Les auteurs déclarent que les travaux de recherche ont été menés en l’absence de toute relation commerciale ou financière pouvant être interprétée comme un potentiel conflit d’intérêts.
Références
[1] ↑ Spinney, L. 2017. Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How It Changed the World. London: Jonathan Cape.
[2] ↑ Larson, H., and Schulz, W. 2015. The State of Vaccine Confidence Report.
[3] ↑ Available online at: https://www.theguardian.com/world/2008/nov/27/south-africa-aids-mbeki (accessed 13, January).
[4] ↑ Available online at: https://www.sciencemag.org/news/2019/01/fighting-ebola-hard-congo-fake-news-makes-it-harder (accessed 13, January).